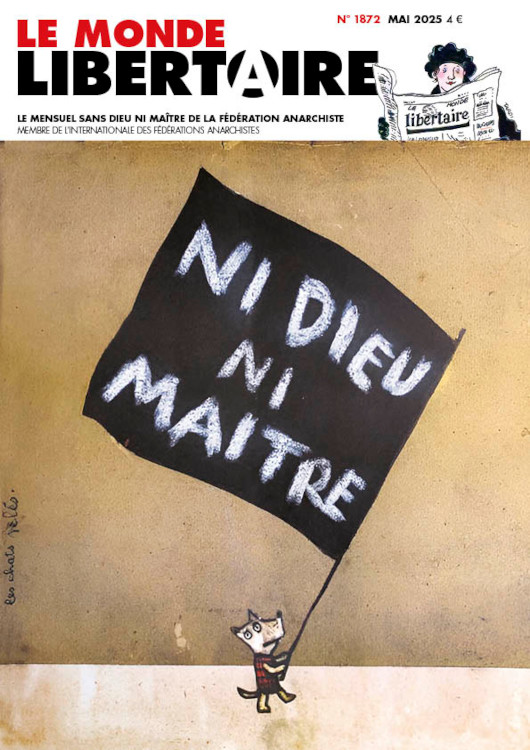Le zapatisme sur le chemin des oubliettes ?
mis en ligne le 23 juin 2011
Et pourtant, les zapatistes et leurs sympathisants ont toujours autant besoin de soutien et de solidarité, et il semble impératif que leurs réalisations – et les coups durs qu’ils subissent de la part des autorités – soient abondamment relayées un peu partout dans le monde. D’autant qu’il ne s’agit plus simplement de soutenir des personnes en lutte, mais d’encourager et d’aider la pérennisation et le développement d’une expérience sociétale hors du commun, condamnant les logiques néolibérales et questionnant le pouvoir dans un sens profondément libertaire. Une expérience qui réactualise les réflexions et les pratiques que nous, anarchistes, développons depuis des années. Et cette solidarité est d’autant plus nécessaire que les autorités mexicaines ne cessent d’empêcher le développement de cette autonomie en s’en prenant directement à ceux qui œuvrent à sa construction. Régulièrement, les communes autonomes et les sympathisants des zapatistes se font harceler par les autorités officielles et des groupes paramilitaires privés qui créent un climat de terreur en multipliant les intimidations, les agressions, les arrestations, les enlèvements et les assassinats. Outre les événements de San Sebastián Bachajón déjà relatés dans les colonnes de ce journal, relevons aussi la situation dramatique de la communauté indigène de Santa María Ostula qui, depuis le 29 avril 2009, essaie de construire son autonomie. Pour l’empêcher, les assassinats se sont multipliés. Rien qu’en cette année 2011, on en compte une dizaine : ceux d’Ernesto Nicolás López (1er janvier 2011), de Pedro Nazario Domínguez (6 janvier 2011), de Pedro Guzmán (1er février 2011), d’Isidro Mora Domínguez (20 mars 2011), de Feliciano Cirino Domínguez (20 mars 2011), de Jonathan et Fortino Verdía Gómez (2 mai 2011), de Nicolás et Rafael de la Cruz (28 mai 2011), et de Juan Faustino (29 mai 2011). À ces nombreux assassinats, ajoutons également les enlèvements d’Horacio Martínez Ramos (10 décembre 2010) et d’Enrique Domínguez Macías (8 avril 2011). Notons aussi l’impossibilité, à l’heure qu’il est, pour les comuneros de la commune de San Juan de Copala – qui avaient fui leur village pour échapper à la répression suite à la proclamation de l’autonomie le 1er janvier 2007 – de retourner chez eux en raison de la présence de plus de 1 200 hommes armés du Mouvement d’unification et de lutte triqui (Multp) et de l’Unité de bien-être social de la région triqui (Ubisort), deux groupes paramilitaires qui entendent bien les empêcher de revenir et de reprendre la construction de l’autonomie.
Il est donc toujours impérieux de poursuivre l’information sur cette situation mexicaine, de relayer les exactions des autorités et des groupes privés – à la solde des premiers –, les luttes et les résistances, mais aussi d’informer sur le projet de construction de l’autonomie et de l’analyser. D’autant plus que si, à l’origine, il est lié à des réalités profondément mexicaines (problématique indigène, fédéralisme étatique, etc.), les principes et les pratiques sur lesquels il se fonde sont « universels » : participation effective de tous aux prises de décision à travers un système d’assemblées générales souveraines, recherche du consensus, rotations des « mandats » (définis au préalable collectivement), contrôle des « mandatés » (le fameux « commander en obéissant »), etc. Ce caractère « international » est d’autant plus fort que le zapatisme lui-même a su sortir de la problématique purement indigène pour épouser et s’ouvrir à d’autres combats, comme en témoigne, en 2006, la création de l’Autre campagne, un mouvement visant à rassembler toutes les luttes mexicaines dites « en bas à gauche » (populaires et anticapitalistes). Bien loin de certains mouvements indigénistes prônant un conservatisme culturel oppressant (et bien souvent justifié au nom d’un relativisme qui a toujours bon dos pour tolérer tout et n’importe quoi), le zapatisme se nourri sans cesse d’apports extérieurs, quitte à remettre en question des usages dits « traditionnels » (ce qui est particulièrement vrai pour les questions de sexualité, de place et de considération des femmes). Le mouvement anarchiste international a beaucoup à apprendre et à puiser dans cette réactualisation de la théorie et de la pratique libertaires (notamment pour sortir du douillet refuge d’un certain purisme idéologique qui, bien souvent, ne sert qu’à justifier l’immobilisme), même si elle est menée par des individus qui ne se revendiquent pas comme tels et qui évoluent dans un imaginaire culturel et politique quelque peu différent du nôtre.
COMMENTAIRES ARCHIVÉS
makhnober
le 18 septembre 2011
Salut et fraternité;quelles nouvelles de la commune D'Oaxaca ?